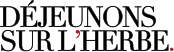Au-delà des idées reçues : le vrai visage de la viticulture nordique
Du 16 au 18 mai, la deuxième édition du festival « Des mets et des mots » se tiendra à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, dans l’Aisne. L’agence Sublimeurs y organisera une table ronde consacrée aux vins des Hauts-de-France. De nombreuses confusions persistent lorsqu’on évoque les nouveaux territoires viticoles français comme la Bretagne et les Hauts-de-France. Le public, souvent influencé par certains médias, tend à attribuer ce phénomène uniquement au changement climatique, espérant voir des conditions méditerranéennes s’installer dans le nord de la France. Aussi simpliste que cela puisse paraître, on comprend l’origine de cette idée erronée. Mais cela soulève une autre question : le vin est-il encore considéré comme une boisson sacrée où l’argent n’intervient jamais ?

Vignes de chardonnay sur le Terril d’Haillicourt- Charbonnay
La libéralisation du marché : le véritable moteur de l’expansion viticole
La principale raison de la production de vin dans le nord de la France (Hauts-de-France et Bretagne) est que la France a dû se conformer aux règles européennes de libre concurrence. Pour résumer, après la crise du phylloxéra et la création du système des Appellations, il avait été décidé de ne replanter que dans les zones où les vins étaient considérés comme qualitatifs. Cette décision visait à maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande, évitant ainsi des crises économiques comme celle de 1907 (révolte des vignerons du Languedoc-Roussillon). Dès l’origine, cette vision très française constituait un contrôle du marché.
Un siècle plus tard, en 2007, l’Union européenne a modifié le système des vins de pays pour offrir aux vignerons davantage de liberté en matière de communication. Ils ont été autorisés à ajouter des informations sur les cépages et même le millésime, moyennant des démarches administratives supplémentaires, laissant ce choix à leur discrétion. À partir de 2010, il est devenu évident pour les consommateurs que les Vins de France n’étaient plus simplement « La Villageoise ». Un effet inattendu de ce changement a été l’émergence de vignerons stars. La catégorie des vins de pays, en s’affranchissant du principe central des AOC focalisé sur le terroir, a offert une voie royale à une génération de néo-vignerons pour créer de nouveaux styles de vins.
Les pionniers du mouvement
Voici quelques exemples notables :
- Richard Leroy (domaine des Noël), produisant des vins blancs secs dans la région des Coteaux du Layon
- Hervé Bizeul (Le Clos des fées), élaborant des vins mono-cépages dans le Roussillon
- Mas Daumas Gassac, utilisant des cépages bordelais en Languedoc
Il ne s’agissait pas simplement d’une tendance, mais du début de l’expansion des vins nature.
Redécoupage territorial et libéralisation : des opportunités inédites
Revenons à notre sujet principal. En 2017, la France a connu un redécoupage régional. L’un des effets a été l’intégration de l’Aisne, un département champenois, dans les Hauts-de-France, rejoignant la région Nord avec Lille comme préfecture. Un phénomène similaire s’est produit en Bretagne avec le Pays Nantais. Imaginez les conséquences en termes de production viticole : comment expliquer que dans une même région, certains puissent produire des vins (comme le Champagne) tandis que d’autres ne pouvaient produire que sous le cadre associatif, sans possibilité de commercialisation ? La vigne a toujours été cultivée dans ces régions, comme en Belgique et en Angleterre, mais uniquement dans un cadre associatif (comme en photo le Charbonnay) et avec des restrictions (800 ares maximum, portés à 1 hectare en 2017).
Ce fut donc une révolution lorsqu’en 2021, la France a été contrainte d’autoriser la vente de vins sous l’étiquette Vin de France sur l’ensemble de son territoire. Les agriculteurs y ont vu une opportunité d’augmenter leur chiffre d’affaires tout en exploitant des sols souvent impropres à la culture céréalière ou à d’autres productions, en raison de leur situation géographique.
Les sols de cette région sont principalement composés de calcaire, de marnes ou d’argile, particulièrement adaptés au Chardonnay et au Pinot Noir.

La cours de Bérénice, Terrasmesnil, 3ème vendanges sur sols de Silex
Les stratégies d’adaptation à un climat exigeant
Contrairement aux attentes, le climat méditerranéen n’est pas arrivé dans le Nord !
Certains producteurs ont choisi de former des coopératives, tandis que d’autres ont créé leurs propres domaines. Cela explique la coexistence de différents styles de vins : ceux principalement élaborés par des œnologues en cave (le Chardonnay est une excellente matière première pour cela) et ceux conçus pour exprimer un terroir spécifique (grès, silex, calcaire, marnes, etc.).
D’autres ont opté pour la plantation de cépages hybrides résistants comme le Solaris, le Floréal ou le Vidoc, profitant de l’absence de restrictions liées aux règles d’AOC.
Malgré la liberté totale en matière de sélection des cépages et de vinification, le climat frais et les étés courts favorisent principalement les cépages à maturation précoce, comme dans les pays voisins. Les mêmes difficultés existent ici, avec une forte pression du mildiou et de l’oïdium, ainsi que la présence de la mouche Suzuki, rendant presque impossible la culture biologique des variétés non résistantes. Notons toutefois que de nombreux producteurs aspirent à des techniques de vinification durables et les mettent en pratique.

Terres de grès, Fresnicourt le Dolmen, Nouveaux plants de vignes (Pinot Gris et Chardonnay Muscaté)
L’équation économique : un défi de taille
Quatre ans après la libéralisation, on compte environ 30 producteurs de vin dans les Hauts-de-France. Ce nombre limité d’acteurs, associé à une production restreinte en raison des aléas climatiques, facilite la vente de ces vins relativement coûteux. En moyenne, ces vins sont vendus autour de 20 € la bouteille. Le facteur qui influence le plus le prix est la quantité limitée de production. Même la coopérative « Les 130 », qui regroupe 130 viticulteurs, ne peut guère descendre en dessous de 15 € la bouteille pour sa gamme d’entrée.
La question se pose : que se passera-t-il lorsque le nombre de producteurs augmentera ? Comment les consommateurs accepteront-ils de payer ce prix pour des vins qui, soyons honnêtes, sont de bonne qualité mais pas exceptionnels ? Les sols sont encore profonds, riches, conçus pour la culture de pommes de terre, et le climat n’est pas favorable. Même d’excellents exemples comme ceux de « La Cour de Bérénice » et « Terres de Grès« , un domaine familial qui produit, selon moi, ce que j’ai goûté de meilleur dans la région, doivent être vendus au prix d’un Bourgogne Village (pas des Côtes de Nuits, mais des Côtes Chalonnaises).
Concernant la fixation du prix de vente, Laurianne Carbonnaux (terres de grès) explique qu’elle ne réalise pas de grands bénéfices, appliquant simplement une marge classique sur le prix de revient. Ce dernier est assez élevé en raison principalement du climat. Toute personne vivant dans le nord de la France aura remarqué que le changement climatique se traduit principalement par des étés plus nuageux, les vents ayant apparemment changé de direction, et l’effet du Golf Stream se faisant de moins en moins sentir (si vous êtes spécialiste en météorologie, j’aimerais en apprendre davantage à ce sujet).

Pinot noir attaqué par la pourriture grise
Pourquoi produire du vin dans des conditions si difficiles ?
Vous savez probablement que les temps ont été très difficiles pour nos agriculteurs. Ils ont été fortement critiqués par de nombreux citadins, considérés comme responsables de la pollution de l’eau, de l’atmosphère, voire accusés de provoquer la recrudescence des cancers infantiles… Alors que nous oublions souvent que les premières victimes des pesticides et autres traitements chimiques sont les agriculteurs eux-mêmes. Les temps ont été durs pour ceux qui nourrissent le monde.
Je poserai cette question aux viticulteurs le 16 mai, mais je suppose que lorsque leurs premières vendanges sont arrivées, les voisins ont proposé leur aide, heureux de participer à cette nouvelle aventure.
Nous avons tendance à placer les viticulteurs dans une catégorie différente des autres agriculteurs. La viticulture répare-t-elle l’image des agriculteurs ? La vigne est perçue comme quelque chose de sacré, de noble. La production de vin pourrait-elle créer une nouvelle voie pour valoriser davantage ces travailleurs de la terre ?
Ces dernières décennies, les agriculteurs ont développé une forme de tourisme permettant aux familles de visiter leurs exploitations, cueillir des légumes, des fruits, voir des animaux, etc. Mais ce type d’initiative n’a jamais connu le même succès que l’œnotourisme. La production viticole crée cette nouvelle économie pour une région qui souffre d’un manque de tourisme. Imaginez des agriculteurs qui n’ont jamais été valorisés pour leur travail, qui n’ont presque jamais rencontré leur client final, et qui maintenant qu’ils produisent du vin, sont invités chez des cavistes pour faire déguster leurs produits aux consommateurs. Ils sont célébrés pour leur travail, pour le changement qu’ils apportent à notre territoire. Qui aurait pensé que la viticulture pouvait être si gratifiante (réparatrice ?) pour l’ego ?

Association des vignerons des Hauts de France sur la Salon du Touquet
Ce que ces nouvelles régions viticoles nous enseignent sur le vin
Le vin est encore considéré comme quelque chose de magique, de sacré. Le bon côté de la médaille est qu’il crée de nouvelles relations entre consommateurs et producteurs, générant de nouveaux revenus et stimulant le tourisme. La culture de la vigne permet aussi de valoriser nos terroirs issus de notre histoire, par exemple avec le Charbonnay, vin de terril.
De l’autre côté on constate que les gens ont encore du mal à voir que la première raison pour laquelle quelqu’un se lance dans la production de vin est l’ARGENT, et non le changement climatique ou l’amour du vin. Ces dernières motivations peuvent exister, mais elles ne peuvent être les seules. Produire du vin est très coûteux et nécessite des investissements de plusieurs milliers d’euros pour démarrer.
Les viticulteurs n’ont pas le même statut que les autres agriculteurs. C’est un fait. Ils sont perçus d’une certaine manière comme des héros. Alors que le changement climatique rend hasardeuse toute forme de culture, nous devrions davantage nous interroger sur la façon de valoriser tous les agriculteurs de la même manière.
Cela vous a plût ?
Poursuivez votre lecture sur les terroirs des Hauts de France en lisant notre article ici ou rejoignez notre conversation le 16 Mai à Villers-Cotterêts lors du festival des mets et des mots, à 16H00. Participez à notre Soirée « Les Hauts de France sur un plateau » le 03 Juillet 2025